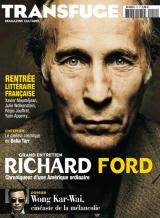
 "J'écris contre le chagrin, la solitude et l'abandon, dans une sorte d'exil"
"J'écris contre le chagrin, la solitude et l'abandon, dans une sorte d'exil"La première nuit de tranquillité, de Stéphane Guibourgé, Flammarion, 377 p., 19€.
Stéphane Guibourgé est un intranquile, un inquiet, un nomade. « Certains hommes ne se sentent pas dignes d’être aimés, alors ils voyagent », aime-t-il à répéter. Face à ses doutes, il a pris la mauvaise habitude de s’envoler aux quatre coins de l’horizon, ou d’écrire des livres, ce qui, au fond, revient au même. Romancier et reporter (notamment au Figaro), raconteur et rapporteur, il mêle avec adresse dans La première nuit de tranquillité fiction et réalité, pour un voyage, encore, au plus profond de l’humain. Avec cette façon, ce besoin viscéral de parcourir des kilomètres pour mieux se parcourir lui-même, Guibourgé s’inscrit dans la tradition non pas des « écrivains voyageurs », mais des écrivains « du voyage », celui, long et jamais achevé, de l’âme. Difficile alors de ne pas penser à Jean-Marie-Gustave Le Clezio, lui aussi grand explorateur du monde et de ceux qui le hantent, « mais c’est trop d’honneur », murmure Guibourgé. Trop d’honneur ? Sûrement pas, mais trop de modestie, oui, sans doute.
C’est sur la route indienne du thé, « là où les paysages ont le goût de la vie », que Vincent et Anne trouveront le courage d’affronter le passé, et un jour peut-être, de s’aimer. Au fil de leur long chemin de vie, comme un écho, Guibourgé s’insinue dans la narration, confiant à son tour au lecteur son voyage intérieur, sa traversée en lui. Comment survivre à l’abandon, comment aimer et pardonner, comment mériter ou provoquer, un soir, sa première nuit de tranquillité…
C’est sur la route indienne du thé, « là où les paysages ont le goût de la vie », que Vincent et Anne trouveront le courage d’affronter le passé, et un jour peut-être, de s’aimer. Au fil de leur long chemin de vie, comme un écho, Guibourgé s’insinue dans la narration, confiant à son tour au lecteur son voyage intérieur, sa traversée en lui. Comment survivre à l’abandon, comment aimer et pardonner, comment mériter ou provoquer, un soir, sa première nuit de tranquillité…
Vous nous avez donné rendez vous à la maison des trois Thés pour nous parler de votre dernier roman, dans lequel coule justement une longue et belle métaphore autour du thé. Le thé comme refuge, repère, art et même philosophie… ?
C’est mieux que ça. Le thé, c’est l’art d’être au monde. Parce que le thé apprend à la fois l’humilité, la mesure et le sens de la rêverie, sans lesquels il me parait difficile de vivre, en tout cas d’être un être tout à fait civilisé. A la fois Vincent voudrait être une personne civilisée totalement dans l’art du thé, et à la fois il est pris, comme happé par une vie occidentale, une vie amoureuse aussi, plus chaotiques. Et finalement il a du mal à trouver un équilibre entre les deux. Après s’être égaré par ambition, il revient à la simplicité du thé en repartant pour l’Inde.
Et vous, quel est votre lien, votre rapport avec le thé ?
Je suis entré un jour chez un marchand de thé, et il m’a fait découvrir que le thé était bien plus complexe que ce que je – et finalement beaucoup de monde- pensais. Je me suis lancé dans la découverte de ses crus, que j’ai appris à connaître avec passion. Je me suis immédiatement senti très proche de cet univers, que je ressens comme une incitation au voyage. Et puis j’ai eu envie d’apprendre. Je suis venu souvent dans des endroits comme celui-ci, véritable temple du thé, pour lire ou travailler, et plus j’avançais, moins j’en savais, plus c’était subtil, sensuel. En fait je suis un ignorant qui avance sur le chemin du thé, ce qui me fait du bien.
Il y a un lieu qui fait figure de personnage dans votre roman, c’est Darjeeling. Il y a un « avant » et un « après » pour vos héros, qui se manifeste aussi dans votre écriture : la ponctuation change, les points de suspension du doute laissent progressivement place aux points d’interrogation, d’exclamation. Qui guide qui ?
Je crois que ce livre m’a, d’une certaine façon, été dicté par mes personnages. A partir du moment où ils rejoignent Darjeeling, leur univers mental se transforme en effet, leur façon d’appréhender le monde, la vie et l’amour se modifie et les mènent, lentement, vers une forme de sérénité, une délivrance. Je ne m’en étais pas aperçu mais cette évolution des personnages a pu influer sur ma forme d’écriture. Ca me fait penser à cette réflexion de Pavese sur l’art du roman : il raconte qu’il n’a jamais su écrire un roman, jusqu’au moment où il a compris que c’était à ses personnages de le guider. Sans doute mes personnages m’ont eux aussi pris par la main. Dans toutes les histoires d’amour, il y a un moment où les deux personnages ne sont plus face à face, mais se placent côte à côte. Et bien une fois à Darjeeling, au pied de l’Himalaya, bercé par la philosophie bouddhiste et l’art du thé, Vincent et Anne se retrouvent à côté, ils regardent dans la même direction.
Une grande partie de La dernière nuit de tranquillité se passe en Inde, mais une Inde assez différente de l’image d’Epinal que l’on en a. Vous écrivez : « L’inde n’est pas seulement spirituelle. Poubelle à ciel ouvert, bûchers qui s’écroulent près des gatts, braises portées par le vent, odeurs dégueulasses sous les mangues, les citrons, le jasmin. Les détritus, les décombres…joyaux dans la lumière ».
J’ai beaucoup voyagé en Inde, et je ne me suis jamais retrouvé dans les récits qu’on en faisait. D’autant plus que j’ai moi-même participé à l’image édulcorée que l’on donne souvent de l’Inde, étant reporter et ayant du répondre à un certain nombre de « commandes » strictes –« le ciel est bleu, les gens sont beaux… »- En réalité l’Inde est d’une complexité que l’on n’imagine pas et que l’on ne peut pas même comprendre. Lors de mon premier voyage là-bas, je venais de terminer l’odyssée entre Bombay et Madras (4 mois de train…), et mon contact là bas me dit en arrivant une chose très vraie : « surtout ne vous retenez pas de juger l’inde. » Je crois que l’on a le droit de ne pas toujours comprendre, de ne pas saisir pourquoi, sur un chemin de temple, des gens enjambent la dépouille d’un très jeune enfant mort alors qu’ils honorent celle d’un vieux singe. Dans ce livre, j’ai vraiment essayé de restituer l’image la plus juste de l’Inde, en tout cas la vision que j’en avais eu, avec ses moments de grâce, et ses moments de violences incompréhensibles.
Vous vous êtes toujours laissé apercevoir dans vos textes, dans celui là vous allez encore plus loin, mêlant fiction et récit à la première personne. Après sept romans et deux recueils de nouvelles, pourquoi tant donner de vous ? Votre enfance, l’abandon, l’adoption, puis plus tard la difficulté à être père…
J’ai toujours su que j’allais écrire sinon ce livre, un livre autour de cela. Il fallait le temps de la vie, de la maturation, peut-être aussi de la distance avec la douleur pour pouvoir le faire. Ensuite pour des raisons bassement techniques et purement artisanales, je pense que je n’avais pas les moyens d’écriture. Je ne voulais pas d’un texte purement autobiographique, mais je voulais que le récit et la fiction puissent se mélanger et se répondre. C’est une mécanique, tout ce qui n’est pas dit dans le roman trouve son éclairage dans l’autofiction, et inversement.
Depuis une dizaine d’années, on s’est presque accoutumé à une autofiction très centrée sur la sexualité de l’auteur. Ici ce n’st pas le cas, vous décrivez des blessures d’une telle profondeur et avec une telle sincérité que l’on en est surpris, et parfois mal à l’aise.
Ce livre là, je ne l’écrirai pas deux fois. Quand je l’ai commencé, je savais que la mise en danger serait « sportive », et elle l’a été. Au dessus de ma table de travail, il y a la représentation d’une toile de Mark Roscoe, et une autre de Francis Bacon. En les regardant, je me disais que l’engagement artistique devait se faire à ce niveau là, ou ne pas se faire du tout. Bien sûr, je ne prétends pas au dixième de ce que Bacon et Roscoe ont pu atteindre, mais j’envie leur engagement, total. Sans le même talent, j’ai voulu que le mien, d’engagement, le soit tout autant. En ce qui concerne la gêne, je vais vous dire : je suis toujours très gêné quand les gens racontent ou écrivent leur sexualité. Non pas que je sois pudibon, mais tout ce qui est fait entre adultes consentant, je ne sais pas si ça apporte quoi que ce soit à la littérature. Je pense que la vraie liberté dans l’écriture de l’autofiction, c’est moins de dévoiler sa sexualité – ce qui est presque devenu « tarte à la crème » aujourd’hui- que de tenter d’aller au fond du puits de son existence.
Justement, une fois au fond de ce puits, qui, dans le cas de vos personnages, est l’abandon –tous l’on été, ou ont abandonné-, comment s’en sortir ? L’amour ?
Bien sur, l’amour, l’acceptation de l’autre avec sa différence, le respect de l’autre, et donc celui de soi même. Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre. Si l’amour est pris en tant que transmission, à ce moment oui, il est le dénominateur commun et le ciment de tous ces personnages, Vincent, Anne, ses parents, Melle Daudet, ou moi. Quant à l’abandon, il nous tient autant qu’il nous ronge. Ce qui nous maintient en vie, c’est à la fois combattre cette douleur et l’attiser. En tout cas il n’y a pas de résilience, pas d’apaisement.
En plus de l’amour, il y a peut-être une autre voie salvatrice dans ce livre, celle de la spiritualité, très présente elle aussi.
A « spiritualité », je crois que je préfère le mot « transcendance ». Quelque chose de plus vaste que ce que l’on peut appeler Dieu ou divinité, quelque chose qui, à Darjeeling ou ailleurs, n’importe où et n’importe quand, vous touche droit au cœur, et vous remplit de gratitude. Une spiritualité hors cadre, hors temple, hors église, d’accord. A un moment, les deux personnages tentent de se fondre dans une culture bouddhiste. Et, sans vraiment la comprendre, ils ont l’humilité de penser que ce n’est peut-être pas leur maison. Que leur présence au monde est aussi importante que leur croyance, qu’il est plus primordial d’être du monde que d’être au monde. Cette voie là peut, en effet, sauver et délivrer de la douleur.
Pour vous en tout cas, auteur et narrateur, le seul secours, le seul recours semble être la littérature.
J’écris contre le chagrin, la solitude, l’abandon, dans une sorte d’exil. Et parfois quand je ne suis pas dans ces sentiments,- parce que parfois, ça arrive, heureusement de plus en plus…-je me dis que je pourrai arrêter d’écrire. Mais en même temps je sais très bien que c’est un pur mensonge. Simplement, j’aimerai écrire de bons livres… J’ai publié plein de livres, dont la plupart sont mauvais.
Vous n’aimez pas vos livres ?
Il y en a deux ou trois que je ne trouve pas trop mal. J’aime bien Le train fantôme, Une vie ailleurs, et j’ai une tendresse particulière pour certaines nouvelles. Les autres, je n’aurai peut-être pas du les faire…Maintenant, s’il fallait les avoir écrit pour arriver à celui-ci… Mais je pense quand même que j’ai beaucoup trop publié, ça c’est sur. J’aurai du continuer d’écrire, sans tout donner.
Et celui là, vous en êtes satisfait?
C’est difficile. Si je vous réponds non, c’est un mensonge. Et en vous répondant oui, ça pourrait être mal interprété. Cela dit je dirai oui quand même. Je suis heureux d’être allé le chercher, ce roman. J’ai mis quatre ans pour le terminer, et je crois que depuis 17 ans que j’écris, j’y pensais. Ensuite il appartient au lecteur de le juger. Mais je suis content d’avoir fait du mieux que je pouvais, car à ce moment là de ma vie, je ne pouvais pas faire mieux.
On a évoqué la forme, singulière, de ce roman. A la fois fiction et récit. Vers quoi vous orientez-vous maintenant ?
J’aimerai vraiment aller vers du romanesque pur. Et je crois que je vais très bientôt cesser de raconter ma vie.
Terminons par le commencement : le titre. La première nuit de tranquillité, autrement dit la mort. En refermant le livre pourtant, c’est l’espoir que l’on retient, sans doute parce que les personnages pardonnent et se pardonnent tout.
C’est exactement ça. A l’origine, «la prima notte di quiete », chez les romains, c’était la mort. C’est d’ailleurs le titre d’un magnifique film italien des années 70, de Valerio Zurlini, et dont l’adaptation en français, « Le professeur », est aussi une pure merveille. Dans ces deux films, il est là encore question de la mort. Mais il y a plein de façons de mourir, et on peut mourir à soi pour mieux renaître. Or, il ne peut pas y avoir de vie, d’amour, s’il n’y a pas de pardon. Je ne crois pas qu’il faille s’attacher aux gens qui sont incapables de pardonner ou qui y voient un signe de faiblesse. Et ce que j’ai essayé de faire, avec ces personnages et moi-même dans mon récit, c’est d’aller vers le pardon, ou en tout cas l’acceptation. C’est très difficile, de « pardonner en conscience », et quand je dis « pardonner en conscience », je ne parle pas d’un chemin spirituel ou religieux. Je ne sais plus qui disait « le plus beau jour de ma vie c’est demain », je suis intimement convaincu de ça. Et peut-être que la première nuit de tranquillité, c’est d’accepter cette idée là.
C’est mieux que ça. Le thé, c’est l’art d’être au monde. Parce que le thé apprend à la fois l’humilité, la mesure et le sens de la rêverie, sans lesquels il me parait difficile de vivre, en tout cas d’être un être tout à fait civilisé. A la fois Vincent voudrait être une personne civilisée totalement dans l’art du thé, et à la fois il est pris, comme happé par une vie occidentale, une vie amoureuse aussi, plus chaotiques. Et finalement il a du mal à trouver un équilibre entre les deux. Après s’être égaré par ambition, il revient à la simplicité du thé en repartant pour l’Inde.
Et vous, quel est votre lien, votre rapport avec le thé ?
Je suis entré un jour chez un marchand de thé, et il m’a fait découvrir que le thé était bien plus complexe que ce que je – et finalement beaucoup de monde- pensais. Je me suis lancé dans la découverte de ses crus, que j’ai appris à connaître avec passion. Je me suis immédiatement senti très proche de cet univers, que je ressens comme une incitation au voyage. Et puis j’ai eu envie d’apprendre. Je suis venu souvent dans des endroits comme celui-ci, véritable temple du thé, pour lire ou travailler, et plus j’avançais, moins j’en savais, plus c’était subtil, sensuel. En fait je suis un ignorant qui avance sur le chemin du thé, ce qui me fait du bien.
Il y a un lieu qui fait figure de personnage dans votre roman, c’est Darjeeling. Il y a un « avant » et un « après » pour vos héros, qui se manifeste aussi dans votre écriture : la ponctuation change, les points de suspension du doute laissent progressivement place aux points d’interrogation, d’exclamation. Qui guide qui ?
Je crois que ce livre m’a, d’une certaine façon, été dicté par mes personnages. A partir du moment où ils rejoignent Darjeeling, leur univers mental se transforme en effet, leur façon d’appréhender le monde, la vie et l’amour se modifie et les mènent, lentement, vers une forme de sérénité, une délivrance. Je ne m’en étais pas aperçu mais cette évolution des personnages a pu influer sur ma forme d’écriture. Ca me fait penser à cette réflexion de Pavese sur l’art du roman : il raconte qu’il n’a jamais su écrire un roman, jusqu’au moment où il a compris que c’était à ses personnages de le guider. Sans doute mes personnages m’ont eux aussi pris par la main. Dans toutes les histoires d’amour, il y a un moment où les deux personnages ne sont plus face à face, mais se placent côte à côte. Et bien une fois à Darjeeling, au pied de l’Himalaya, bercé par la philosophie bouddhiste et l’art du thé, Vincent et Anne se retrouvent à côté, ils regardent dans la même direction.
Une grande partie de La dernière nuit de tranquillité se passe en Inde, mais une Inde assez différente de l’image d’Epinal que l’on en a. Vous écrivez : « L’inde n’est pas seulement spirituelle. Poubelle à ciel ouvert, bûchers qui s’écroulent près des gatts, braises portées par le vent, odeurs dégueulasses sous les mangues, les citrons, le jasmin. Les détritus, les décombres…joyaux dans la lumière ».
J’ai beaucoup voyagé en Inde, et je ne me suis jamais retrouvé dans les récits qu’on en faisait. D’autant plus que j’ai moi-même participé à l’image édulcorée que l’on donne souvent de l’Inde, étant reporter et ayant du répondre à un certain nombre de « commandes » strictes –« le ciel est bleu, les gens sont beaux… »- En réalité l’Inde est d’une complexité que l’on n’imagine pas et que l’on ne peut pas même comprendre. Lors de mon premier voyage là-bas, je venais de terminer l’odyssée entre Bombay et Madras (4 mois de train…), et mon contact là bas me dit en arrivant une chose très vraie : « surtout ne vous retenez pas de juger l’inde. » Je crois que l’on a le droit de ne pas toujours comprendre, de ne pas saisir pourquoi, sur un chemin de temple, des gens enjambent la dépouille d’un très jeune enfant mort alors qu’ils honorent celle d’un vieux singe. Dans ce livre, j’ai vraiment essayé de restituer l’image la plus juste de l’Inde, en tout cas la vision que j’en avais eu, avec ses moments de grâce, et ses moments de violences incompréhensibles.
Vous vous êtes toujours laissé apercevoir dans vos textes, dans celui là vous allez encore plus loin, mêlant fiction et récit à la première personne. Après sept romans et deux recueils de nouvelles, pourquoi tant donner de vous ? Votre enfance, l’abandon, l’adoption, puis plus tard la difficulté à être père…
J’ai toujours su que j’allais écrire sinon ce livre, un livre autour de cela. Il fallait le temps de la vie, de la maturation, peut-être aussi de la distance avec la douleur pour pouvoir le faire. Ensuite pour des raisons bassement techniques et purement artisanales, je pense que je n’avais pas les moyens d’écriture. Je ne voulais pas d’un texte purement autobiographique, mais je voulais que le récit et la fiction puissent se mélanger et se répondre. C’est une mécanique, tout ce qui n’est pas dit dans le roman trouve son éclairage dans l’autofiction, et inversement.
Depuis une dizaine d’années, on s’est presque accoutumé à une autofiction très centrée sur la sexualité de l’auteur. Ici ce n’st pas le cas, vous décrivez des blessures d’une telle profondeur et avec une telle sincérité que l’on en est surpris, et parfois mal à l’aise.
Ce livre là, je ne l’écrirai pas deux fois. Quand je l’ai commencé, je savais que la mise en danger serait « sportive », et elle l’a été. Au dessus de ma table de travail, il y a la représentation d’une toile de Mark Roscoe, et une autre de Francis Bacon. En les regardant, je me disais que l’engagement artistique devait se faire à ce niveau là, ou ne pas se faire du tout. Bien sûr, je ne prétends pas au dixième de ce que Bacon et Roscoe ont pu atteindre, mais j’envie leur engagement, total. Sans le même talent, j’ai voulu que le mien, d’engagement, le soit tout autant. En ce qui concerne la gêne, je vais vous dire : je suis toujours très gêné quand les gens racontent ou écrivent leur sexualité. Non pas que je sois pudibon, mais tout ce qui est fait entre adultes consentant, je ne sais pas si ça apporte quoi que ce soit à la littérature. Je pense que la vraie liberté dans l’écriture de l’autofiction, c’est moins de dévoiler sa sexualité – ce qui est presque devenu « tarte à la crème » aujourd’hui- que de tenter d’aller au fond du puits de son existence.
Justement, une fois au fond de ce puits, qui, dans le cas de vos personnages, est l’abandon –tous l’on été, ou ont abandonné-, comment s’en sortir ? L’amour ?
Bien sur, l’amour, l’acceptation de l’autre avec sa différence, le respect de l’autre, et donc celui de soi même. Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre. Si l’amour est pris en tant que transmission, à ce moment oui, il est le dénominateur commun et le ciment de tous ces personnages, Vincent, Anne, ses parents, Melle Daudet, ou moi. Quant à l’abandon, il nous tient autant qu’il nous ronge. Ce qui nous maintient en vie, c’est à la fois combattre cette douleur et l’attiser. En tout cas il n’y a pas de résilience, pas d’apaisement.
En plus de l’amour, il y a peut-être une autre voie salvatrice dans ce livre, celle de la spiritualité, très présente elle aussi.
A « spiritualité », je crois que je préfère le mot « transcendance ». Quelque chose de plus vaste que ce que l’on peut appeler Dieu ou divinité, quelque chose qui, à Darjeeling ou ailleurs, n’importe où et n’importe quand, vous touche droit au cœur, et vous remplit de gratitude. Une spiritualité hors cadre, hors temple, hors église, d’accord. A un moment, les deux personnages tentent de se fondre dans une culture bouddhiste. Et, sans vraiment la comprendre, ils ont l’humilité de penser que ce n’est peut-être pas leur maison. Que leur présence au monde est aussi importante que leur croyance, qu’il est plus primordial d’être du monde que d’être au monde. Cette voie là peut, en effet, sauver et délivrer de la douleur.
Pour vous en tout cas, auteur et narrateur, le seul secours, le seul recours semble être la littérature.
J’écris contre le chagrin, la solitude, l’abandon, dans une sorte d’exil. Et parfois quand je ne suis pas dans ces sentiments,- parce que parfois, ça arrive, heureusement de plus en plus…-je me dis que je pourrai arrêter d’écrire. Mais en même temps je sais très bien que c’est un pur mensonge. Simplement, j’aimerai écrire de bons livres… J’ai publié plein de livres, dont la plupart sont mauvais.
Vous n’aimez pas vos livres ?
Il y en a deux ou trois que je ne trouve pas trop mal. J’aime bien Le train fantôme, Une vie ailleurs, et j’ai une tendresse particulière pour certaines nouvelles. Les autres, je n’aurai peut-être pas du les faire…Maintenant, s’il fallait les avoir écrit pour arriver à celui-ci… Mais je pense quand même que j’ai beaucoup trop publié, ça c’est sur. J’aurai du continuer d’écrire, sans tout donner.
Et celui là, vous en êtes satisfait?
C’est difficile. Si je vous réponds non, c’est un mensonge. Et en vous répondant oui, ça pourrait être mal interprété. Cela dit je dirai oui quand même. Je suis heureux d’être allé le chercher, ce roman. J’ai mis quatre ans pour le terminer, et je crois que depuis 17 ans que j’écris, j’y pensais. Ensuite il appartient au lecteur de le juger. Mais je suis content d’avoir fait du mieux que je pouvais, car à ce moment là de ma vie, je ne pouvais pas faire mieux.
On a évoqué la forme, singulière, de ce roman. A la fois fiction et récit. Vers quoi vous orientez-vous maintenant ?
J’aimerai vraiment aller vers du romanesque pur. Et je crois que je vais très bientôt cesser de raconter ma vie.
Terminons par le commencement : le titre. La première nuit de tranquillité, autrement dit la mort. En refermant le livre pourtant, c’est l’espoir que l’on retient, sans doute parce que les personnages pardonnent et se pardonnent tout.
C’est exactement ça. A l’origine, «la prima notte di quiete », chez les romains, c’était la mort. C’est d’ailleurs le titre d’un magnifique film italien des années 70, de Valerio Zurlini, et dont l’adaptation en français, « Le professeur », est aussi une pure merveille. Dans ces deux films, il est là encore question de la mort. Mais il y a plein de façons de mourir, et on peut mourir à soi pour mieux renaître. Or, il ne peut pas y avoir de vie, d’amour, s’il n’y a pas de pardon. Je ne crois pas qu’il faille s’attacher aux gens qui sont incapables de pardonner ou qui y voient un signe de faiblesse. Et ce que j’ai essayé de faire, avec ces personnages et moi-même dans mon récit, c’est d’aller vers le pardon, ou en tout cas l’acceptation. C’est très difficile, de « pardonner en conscience », et quand je dis « pardonner en conscience », je ne parle pas d’un chemin spirituel ou religieux. Je ne sais plus qui disait « le plus beau jour de ma vie c’est demain », je suis intimement convaincu de ça. Et peut-être que la première nuit de tranquillité, c’est d’accepter cette idée là.
Marine de Tilly.






















